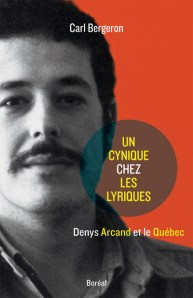Livres
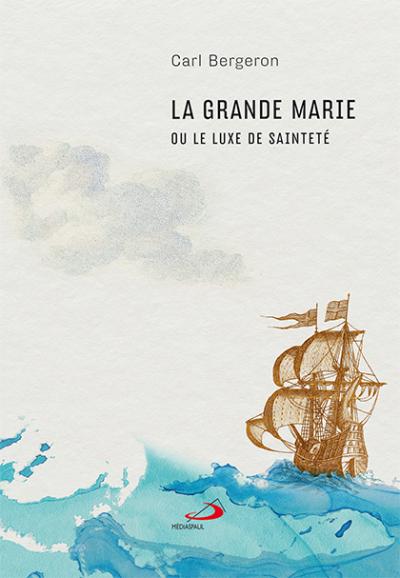
Imaginons une barque qui remonte le fleuve Saint-Laurent, entre ses rives escarpées, depuis Tadoussac et accoste à Québec le 1er août 1639 après une escale à l’île d’Orléans. Dans cette barque, éprouvées par trois mois de traversée depuis Dieppe, trois religieuses ursulines, dont l’une, ayant quitté son couvent de Tours, dotée d’un fort tempérament, aussi bien tourné vers l’action que vers la mystique, apparaît déjà comme une figure centrale : Marie de l’Incarnation. N’imaginons plus. À quatre siècles de distance, c’est son portrait que brosse ici, d’une main leste, d’un œil admiratif, l’écrivain Carl Bergeron, séduit par la force de caractère, les qualités d’organisatrice et le grand talent d’épistolière d’une femme portée par un désir d’absolu.
À travers le prisme de ce destin hors du commun, Carl Bergeron interroge la société québécoise, notre époque, ses lâchetés, son amnésie souvent. D’un même coup de fleuret, il égratigne l’université quand elle n’est que refuge, l’esprit bourgeois quand il n’est que calcul. Plus que tout, son chant d’amour à la «Grande Marie», aussi beau que nécessaire, est tourné vers l’avenir : «N’allons pas croire, naïfs que nous sommes, que Marie est morte en 1672 et qu’elle s’est arrêtée là. […] Il se pourrait que le XXIe siècle fasse de Marie de l’Incarnation une contemporaine, et la ressuscite plus proche et vibrante à notre conscience qu’un Proust, un Céline ou un Joyce.»
*

Un écrivain peut adopter la fiction, l’essai ou l’autobiographie, cela le concerne ; tant que la forme et le fond s’accordent et que le monde est abordé depuis la singularité d’un style, on reste dans le domaine de l’art, c’est-à-dire de la représentation.
Le « journal » qu’on lira dans ce livre n’est pas un vrai journal : il est le moyen dont l’écrivain a usé, parmi de nombreux autres, pour exprimer le plus fidèlement possible une vérité qui autrement serait restée tue. Chaque entrée de ce journal, chaque paragraphe, chaque ligne, chacun de ses nombreux retours dans le temps et chacune de ses digressions ont été soupesés, médités, pensés comme les morceaux d’un ensemble organique.
Le texte doit donc être lu comme une oeuvre unifiée, comme une cosmogonie où les observations répondent aux sensations, les sensations aux souvenirs, les souvenirs à l’intuition poétique, l’intuition poétique aux sentiments. Il raconte l’expérience d’une métamorphose, au cours d’une année décisive où toutes les années vécues auraient pour ainsi dire resurgi. Mémoire blessée découlant tantôt du passé national, tantôt du passé intime, qui place l’héritier seul face à son destin.
L’auteur, ici, parle sérieusement : il met sa vie et son nom en jeu, et le fait à visière levée. À quelle noblesse outragée puise ce duel féroce entre l’individu et la communauté, entre l’aspiration à la beauté et la fatalité de l’Histoire, il faudra attendre jusqu’à la toute dernière ligne pour vraiment le comprendre, et en juger.
*
« J’ai lu votre texte. Il m’a beaucoup touché. C’est, de toute ma vie, parmi les plus exacts que j’aie lus sur mon travail. » Tels ont été les premiers mots de Denys Arcand à Carl Bergeron, jeune essayiste de quarante ans son cadet, après qu’il a pris connaissance de Un cynique chez les lyriques. En effet, c’est un portrait sensible du cinéaste que l’auteur ébauche ici à travers une lecture et une interprétation serrées de son travail, des premiers films pour l’ONF jusqu’aux films de consécration. Lettré casanier et ironique, lecteur de Gibbon et de Machiavel, pré-boomer étranger au nationalisme canadien-français comme au lyrisme de la Révolution tranquille, Arcand cultive une sensibilité en porte-à-faux avec les grands mythes collectifs qui ont forgé la société québécoise. Cette sensibilité, d’aucuns l’ont qualifiée avec raison de « cynique », sans avoir toujours conscience de la signification du mot, qu’ils attribuent à un trait de caractère plus qu’à une intelligence des choses.
Dans une langue claire et élégante, Carl Bergeron remonte aux sources intimes du cynisme philosophique d’Arcand et montre au contraire la filiation trouble et émouvante qui n’a cessé d’unir celui-ci à son pays natal, dans une tension permanente entre le sentiment d’appartenance et la nécessité de faire une œuvre. En complément de lecture, un Denys Arcand attentif lui fait écho par des annotations mordantes et éclairantes, évoquant tantôt des anecdotes, proposant tantôt des explications sur son parcours.